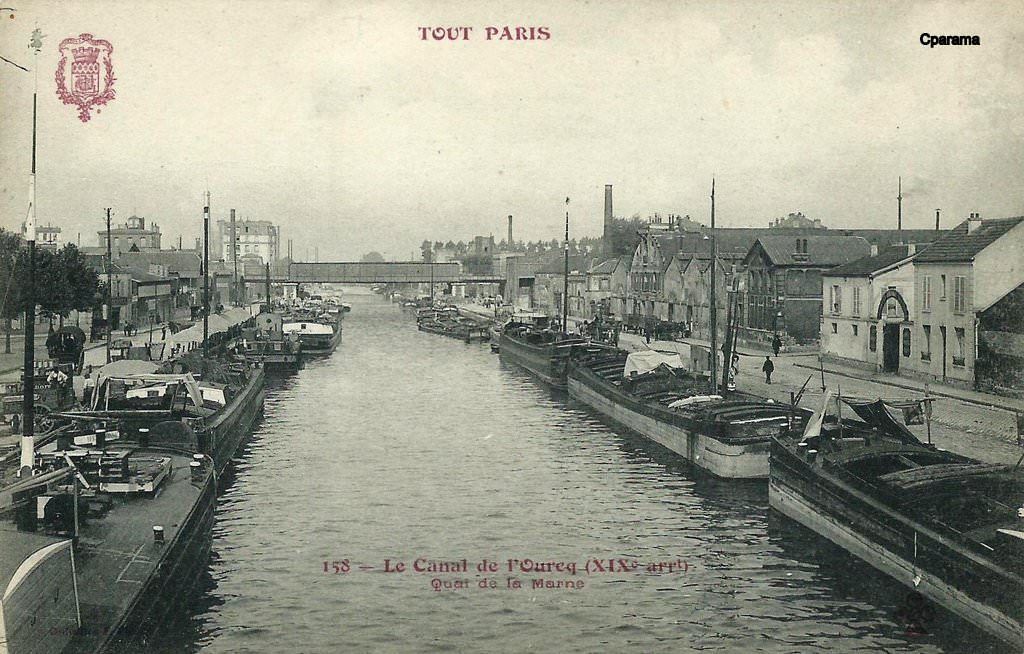TOUT PARIS - 1843 - Rue Saint-Antoine (IVe arrt.)
Le cliché de la carte présentée ici est pris à hauteur du
n°13 rue Saint-Antoine, anciennement n°222 jusqu’en 1901. Comme on peut le voir, le second étage est occupé par un photographe : il s’agit de
Jean-Claude Marmand, né le 25 mars 1840 à Marlieux dans l’Ain, marié à Mulhouse depuis le 9 juin 1870 avec Rosalie Célestine Corhumel (1838-1922), lesquels avaient repris de M. Blanc, en 1895, cet atelier de photographie qu’ils tenaient toujours en 1922.
Au rez-de-chaussée gauche du même bâtiment, le café bar a appartenu de 1896 à 1900 à un certain Mousseau qui y tenait un café-concert à l’enseigne de La Pigeonne. En 1908, il était redevenu un simple café sans musique dénommé Le Tilly-bar.
La partie droite de l’immeuble (également
n°13 Saint Antoine, mais numérotée n°220 jusqu’en 1901) est affermée, comme l’indique l’enseigne perpendiculaire placée en façade du 1er étage, à
Pierre-Alcide Léger (1867-1947), chapelier, né à Condat en Haute-Vienne, marié le 7 janvier 1899 avec Marie-Irma Le Maux dont les parents, également chapeliers demeuraient au n°35 rue Rambuteau.
Cette chapellerie, spécialisée dans les chapeaux en poil de castor, mais également en feutre et en soie, avait été créée en 1848, rue Saint-Antoine, par
Lazare Gustave Puriau (1822-1884), né à Ceton dans l’Orne, marié le 8 février 1845 avec Jeanne Allain (1812-1893) ; son frère, Charles Bienaimé Puriau (1810-1886), qui exerçait la même profession, était installé au n°27 (devenu n°21) rue de la Cité, depuis 1847.
Au décès de Puriau le 10 septembre 1884, sa veuve cède le commerce, le 4 décembre 1884, à la demoiselle
Jeanne Rémy, née à Choisy-le-Roi le 8 janvier 1861, demeurant avec sa mère Benonie Aline Rémy (1837-1891), chapelière avec elle.
Le 11 mai 1886 Jeanne Rémy convole avec
Alfred Eloi Fauvet (1857-1898), originaire de Ceton dans l’Orne comme Puriau son prédécesseur chapelier. Après le décès de Fauvet le 7 janvier 1898, Jeanne Rémy conserve la chapellerie jusqu’en 1901 avant de la céder à
Pierre-Alcide Léger et à son épouse qui y étaient toujours actifs en 1932…

publié par zelig ven. 25 févr. 2022 12:19 ►
ICI
Dans le petit immeuble de deux étages attenant, formant l’angle du
n°15 rue Saint-Antoine (ex n°218) et du
n°20 rue Castex (devenu le n°14 en 1880), se tient, au rez-de-chaussée, un commerce de vins, dont l’enseigne délavée indiquait encore en 1870 «
A la Renommée de l’Escargot », enseigne assez fréquente qu’on peut voir, au XIXe siècle, à Troyes, à Reims, à Rouen ou encore à Dijon.
Cette gargote est exploitée par Leprêtre qui y est attesté de 1842 à 1850, suivi par Bonnet (1851 à 1856), la veuve Teissèdre (1857), A. Picart (1858 à 1864), A. Loiseau (1870 à 1879), Charles Schmit (1880 à 1882), Marcel Rayé (1883 à 1890), L. Bresson (1893), Granger (1894), J. Ayral (1895-1896), E. Bourian (1898 à 1902), Pousset (1903 à 1905), Beckerig (1906), Cathelat (1907 à 1913), Boissonnade (1914 à 1922)...
Un
salon de coiffure est aménagé au premier étage, tenu par Jean Toulouse en 1870 et 1871, Victor Foucault de 1873 à 1878, U. Dufresne en 1879-1880, Carillon de 1881 à 1891 etc…
Au second étage,
Jean Teissèdre (1818-1856) a installé une officine de «
Remplacement militaire » en 1854.
Pas moins d’une trentaine de ces établissements, apparentés à des compagnies d’assurances, s’étaient établis à Paris, proposant contre paiement, d’exonérer du service militaire leurs adhérents. La conscription étant faite, à cette époque, par tirage au sort, les bureaux de remplacement militaire se chargeaient de trouver des volontaires, de pauvres hères en général, pour effectuer les obligations militaires à leur place, moyennant quelques deniers…
Jean Teissèdre n’aura pas profité longtemps du système, puisqu’il décède le 16 avril 1856, à l’âge de 38 ans. Sa veuve reprend l’année suivante, pendant un an, le café du rez-de-chaussée, tandis qu’un certain
Pruvot qui disposait déjà d’une maison de Remplacement militaire, connue sous le nom de Comptoir d’Exonération du Service Militaire, située au n°14 rue du Cardinal Fresch et d’une succursale au n°2 rue Vieille du Temple, reprend celle du n°218 rue Saint-Antoine laissée libre au décès de Teissèdre.
Les nombreuses réclames de Pruvot précisaient notamment que «
La maison assure aussi avant le tirage ; elle offre toute sécurité et solvabilité, n’exige le payement qu’après entière libération et traite directement avec les remplaçants ; au besoin offre un dépôt de fonds entre les mains des assurés pour garantir le remplacement » ou encore «
La maison Pruvot se charge du remplacement après le tirage et des substitutions de numéros, accorde toutes facilités pour le paiement, et offre toute garantie de sécurité ».
La loi du 27 juillet 1872 rendant obligatoire le service militaire pour tous, à compter de 19 ans, tous les bureaux de remplacement militaire seront aussitôt fermés. Celui de Pruvot ne fera pas exception et sera occupé jusqu’en 1878 par un agent d’affaires et de placement du nom de Mélissent, à qui a succédé un certain Henri de 1879 à 1888…
La Maison du n°218 rue Saint-Antoine à l'angle du n°20 rue Castex, en piteux état à la suite des échauffourées des 24 et 25 mai 1871

Au n°17 rue Saint-Antoine (n°216 jusqu’en 1901), l’actuel
Temple protestant Sainte-Marie a été construit sur les plans de l’architecte François Mansart (1589-1666).
Ce que nous savons, c’est qu’en 1619 des religieuses de la Visitation sont venues de Bourges s’installer à Paris, sur les ordres de Saint-François de Sales, dans l’Hôtel du Petit-Bourbon placé « entre deux tripots et d’où l’on entendait jour et nuit le tintamarre des joueurs », maison située rue du Petit-Musc et de la Cerisaie (rue de la Cerisaie parallèle à la rue Saint-Antoine, située à l’arrière de celle-ci). Après avoir passé deux ans, à cet emplacement, les Visitandines s’établissent définitivement rue Saint-Antoine.
Grâce à la dot (donation) de 45.000 livres tournois, apportée par la mère supérieure
Hélène Angélique Lhuillier (1592 – 25 mars 1655), la congrégation fait l’acquisition, le 18 février 1621, auprès de
Jean-Antoine Zamet (1584-1622), fils du banquier Sébastien Zamet, de l’Hôtel de Cossé-Brissac (ex Hôtel de Boissy) et de ses dépendances, au prix de 48.000 livres. Cette propriété provenait, antérieurement, de la succession de l’architecte Philibert de l’Orme (1514-1570) qui avait acheté ces parcelles en 1554 au premier écuyer d’Henri II, François de Kernevenoy, pour 6.125 livres, pour y construire sa propre maison. Les visitandines vont encore accroître leur domaine conventuel par l’acquisition de parcelles attenantes, au prix de 36.000 livres, auprès de la veuve de Zamet, Jeanne de Goth, dame de Rouillac.
La première pierre de la future église du couvent des Visitandines est posée le 31 octobre 1632 et un marché est passé avec l’entrepreneur Michel Villedo (1598-1667). L’édifice, dédié à Notre-Dames-des-Anges, est consacré le 14 septembre 1634 par l’archevêque de Bourges André Frémyot.
Lors de la révolution, les Filles de la Visitation sont expulsées de leur couvent qui est aussitôt démoli, morcelé et vendu en 1792. L’Etat s’approprie la ci-devant Eglise Notre-Dame-des-Anges qui est affermée en date du 18 vendémiaire de l’an IX (10 octobre 1800) au Consistoire, afin d’y célébrer le culte protestant.
Par un arrêté du 12 frimaire de l’an XI (3 décembre 1802), le premier consul, Napoléon Bonaparte, assigne trois temples à l’Eglise réformée de Paris : Saint-Louis-du-Louvre, qui sera rasé pour l’agrandissement du Carrousel et remplacé par l’Oratoire de la rue Saint-Honoré ;
Sainte-Marie du Marais de la rue Saint-Antoine ; l’Eglise de Panthémont, à l’angle de la rue de Bellechasse et de Grenelle-Saint-Germain.
C’est le pasteur Paul-Henri Marron (1754-1832) qui, le 18 floréal de l’an XI (8 mai 1803), adressera un discours inaugural, lors de sa prise de fonction dans la désormais Eglise réformée Sainte-Marie du Marais.
Lors de l’insurrection de mai 1871, la rue Saint-Antoine, le quartier de la Bastille et le Temple du Marais ne sont pas épargnés par la multitude d’obus qui s’abat sur Paris. Après ce déluge et les exécutions qui s’ensuivent, de nombreux monuments sont incendiés. Le Temple Sainte-Marie en sera quitte pour une profonde restauration dont l’architecte Marcellin-Emmanuel Varcollier (1829-1895) sera chargé de 1872 à 1874.
Temple protestant Sainte-Marie au n°216 rue Saint-Antoine après le déluge d’obus de mai 1871, pendant la commune

Quelques journaux nous donnent une description des lieux, après les destructions de mai 1871 dans le quartier de la rue Saint-Antoine :
— Toute la rue Saint-Antoine, du côté droit, depuis l’église Saint-Paul jusqu’à la Bastille, a été criblée par les obus ; les maisons sont presque toutes démolies.
Le temple protestant est à jour, les projectiles l’ont transpercé ; le magasin du Paradis des Dames ne tient plus. L’église Saint-Paul a une partie de sa toiture enlevée.
La place de la Bastille est affreusement abimée.
(L’Union libérale du 2 juin 1871)
—
Le temple protestant situé au coin de la rue Castex et de la rue Saint-Antoine a été criblé d’obus. La façade est ébréchée sur plusieurs points, et le clocher est à demi fracassé.
(La Gazette de France du 2 juin 1871)
Tableau des incendies et destructions de Paris ordonnés et causés par la Commune dans la seconde quinzaine de mai 1871
—
Rue Saint-Antoine. Cette rue n’a pas eu d’incendies, mais de très nombreux projectiles l’ont endommagée. Nous citerons les n°148, 156, 158, 168, 172, déjà réparés, et les n°178 180, 182, 184, 212, ce dernier à l’angle de la rue du Petit-Musc, ancien Hôtel de Mayenne. Au n°216, la façade et le dôme du Temple protestant au coin de la rue Castex ont reçu bon nombre d’obus. Les n°214, 218, 222, grande distillerie Marchand, 232, 234, 236, 199 et 201.
(Le Moniteur universel du 17 juin 1871)